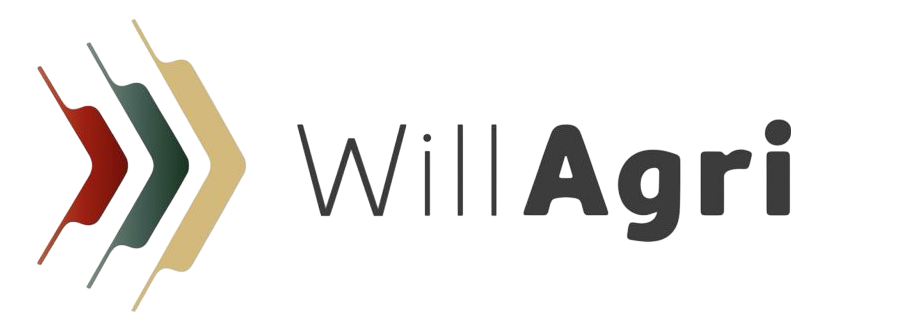Selon une étude de Nature, certaines de nos cultures de base essentielles pourraient subir des pertes de production « substantielles » en raison du dérèglement climatique, même si les agriculteurs s’adaptent à la détérioration des conditions météorologiques. Ainsi, les rendements du maïs, du soja, du riz, du blé, du manioc et du sorgho devraient diminuer de 120 calories par personne et par jour pour chaque degré de réchauffement de la planète, les pertes quotidiennes moyennes pouvant représenter l’équivalent de l’absence de petit-déjeuner. Selon l’étude, l’augmentation des revenus et la modification des pratiques agricoles permettraient d’endiguer ces pertes d’environ un quart d’ici à 2050 et d’un tiers d’ici à 2100, sans toutefois les stopper complètement. « Dans un avenir où le réchauffement est élevé, nous constatons toujours des pertes de productivité calorique de l’ordre de 25 % à l’échelle mondiale », a déclaré Andrew Hultgren, économiste de l’environnement à l’université de l’Illinois Urbana-Champaign et auteur principal de l’étude.
Les agriculteurs sont parmi les plus durement touchés par les phénomènes météorologiques extrêmes, mais les scientifiques ont eu du mal à quantifier les effets du changement climatique sur la production alimentaire. L’une des principales sources d’incertitude est la mesure dans laquelle les agriculteurs s’adapteront à des températures plus élevées en modifiant les cultures qu’ils utilisent, le moment où ils les plantent et les récoltent et la manière dont ils les cultivent.
L’ampleur et la nature des effets des dérèglements climatiques varient suivant les régions et les cultures. Les principaux problèmes proviennent de l’augmentation des températures, du stress hydrique, des événements météorologiques extrêmes, des maladies et des ravageurs et de l’effet fertilisant à double tranchant du CO2.
Le dérèglement climatique entraîne une baisse généralisée des rendements agricoles pour la plupart des cultures à long terme, en raison d’une combinaison de facteurs tels que l’augmentation des températures, le stress hydrique et la fréquence accrue des événements météorologiques extrêmes. Si certaines régions peuvent connaître des avantages temporaires , les projections globales indiquent une vulnérabilité croissante et des défis majeurs pour la sécurité alimentaire mondiale. Le riz, selon des études récentes, pourrait être la culture la moins impactée en termes de baisse de rendement à l’échelle mondiale d’ici 2100, grâce à sa grande adaptabilité. Revue des effets négatifs du dérèglement climatique sur les principales cultures vivrières.
1. Les facettes du dérèglement climatique



L’augmentation des températures
Maïs et blé. Les températures élevées peuvent raccourcir la durée du cycle des cultures, entrainant une diminution de l’accumulation de la biomasse et des rendements. Des « coups de chaud » au moment du remplissage des grains sont particulièrement préjudiciables. Cependant, dans certaines régions plus froides, une augmentation modérée des températures peut être initialement bénéfique en permettant des semis plus précoces et une plus longue période de photosynthèse. À long terme, l’augmentation des températures excède le seuil de tolérance optimale dans de nombreuses régions.
Riz. Des températures élevées peuvent induire un stress thermique, affectant le rythme de croissance et le développement des plants. Une hausse des températures réduit la durée du cycle, ce qui peut nuire aux rendements.
Sorgho. L’augmentation des températures, surtout extrêmes, peut endommager les cellules des plantes et augmenter le taux de stérilité au stade de la floraison, entraînant une diminution des rendements. Cependant, certaines études suggèrent une résilience du sorgho à la hausse des températures dans certaines zones, voire un effet positif dans certains scénarios.
Soja. Les températures élevées peuvent favoriser la propagation de certaines maladies comme la tache cible, bien que l’impact global sur la productivité du soja reste complexe et dépende de la concentration de CO2 et d’autres facteurs.
Manioc. Bien que relativement résistant à la sécheresse, le manioc reste sensible aux variations de température qui peuvent influencer son cycle de croissance et le développement des racines tubéreuses.
Stress hydrique
- Toutes ces cultures sont vulnérables aux sécheresses qui réduisent la disponibilité en eau essentielle à leur croissance et leur productivité. Une diminution de la pluviométrie entraîne une augmentation de la demande en eau des végétaux.
- Les précipitations erratiques, avec des épisodes de pluies intenses suivies de périodes sèches, peuvent provoquer des inondations (entraînant des pertes de cultures) ou des déficits hydriques.
- Le maïs, le blé et le sorgho sont particulièrement affectés par les variations de précipitations et les sécheresses.
- Le manioc, bien que relativement résistant à la sécheresse (il peut supporter 4 à 6 mois de sécheresse grâce à ses racines tubéreuses) n’est pas exempt d’impacts en cas de sécheresses prolongées ou d’excès d’eau.
- Le riz, une culture qui dépend fortement de l’eau, est directement impacté par les changements dans les régimes de précipitations, que ce soit par le manque d’eau ou par des inondations.
Événements météorologiques extrêmes
- L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements extrêmes tels que les canicules, les inondations, les tempêtes et les vagues de froid peuvent détruire les cultures, réduire les rendements et endommager les infrastructures agricoles.
- Ces événements peuvent avoir un impact dévastateur sur les récoltes de maïs, blé, riz, soja et sorgho, entraînant des pertes significatives pour les agriculteurs. Le blé tendre, par exemple, a connu de très mauvaises moissons suite au dérèglement climatique.
Effets sur les maladies et les ravageurs
Le changement climatique peut modifier la répartition géographique et l’intensité des maladies et des ravageurs, en créant des conditions plus favorables à leur développement ou en les poussant vers de nouvelles zones. C’est le cas pour la tache cible du soja, par exemple.
Effet fertilisant à double tranchant du CO2
Paradoxalement, une augmentation du dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère peut stimuler la photosynthèse et potentiellement augmenter la productivité et le rendement en matière sèche de certaines cultures. Cependant, cet effet bénéfique est souvent limité par les autres facteurs négatifs du changement climatique, comme les températures extrêmes et le stress hydrique.
Un certain nombre de pratiques agricoles ont vu le jour qui peuvent, dans une certaine mesure , limiter les effets négatifs du dérèglement climatique, freiner, sans enrayer, la baisse tendancielle des rendements.
2. Les pratiques de lutte contre le dérèglement climatique
Les pratiques agricoles courantes de culture des plantes essentielles pour s’adapter au dérèglement climatique passent par une combinaison de stratégies génétiques (variétés adaptées) et agronomiques (gestion de l’eau, du sol, des cultures) pour construire des systèmes agricoles plus résilients et durables. Il est des pratiques universelles et des pratiques spécifiques à chaque culture.
Les pratiques générales d’adaptation au dérèglement climatique sont les suivantes :
- Sélection variétale : développer et utiliser des variétés de culture plus résistantes à la sécheresse, à la chaleur, aux maladies et aux ravageurs (qui peuvent proliférer avec les changements climatiques) ou des variétés avec des cycles de croissance plus courts pour échapper aux périodes de stress hydrique ou de chaleur intense.
- Diversification des cultures et rotations : introduire une plus grande variété de cultures dans l’assolement, y compris des légumineuses, pour améliorer la santé des sols, réduire les risques liés aux maladies et ravageurs spécifiques et augmenter la résilience globale du système face aux aléas climatiques.
- Agriculture de conservation :
-
- Réduction du travail du sol (labour) : diminuer le labour permet de préserver la structure du sol, d’augmenter sa teneur en matière organique et d’améliorer sa capacité à retenir l’eau.
- Couverture permanente des sols : maintenir une couverture végétale (cultures de couverture, résidus de récolte) permet de protéger le sol de l’érosion, de limiter l’évaporation de l’eau et d’enrichir la matière organique.
- Gestion de l’eau :
-
- Irrigation maîtrisée et de précision : utiliser des techniques d’irrigation efficaces (goutte-à-goutte, micro-irrigation) et des capteurs pour optimiser l’apport en eau et réduire le gaspillage.
- Collecte et stockage de l’eau : mettre en place des systèmes pour collecter et stocker l’eau de pluie.
- Pratiques de conservation de l’humidité du sol : digues liées, fosses de plantation ou cultures en courbes de niveau pour retenir l’eau.
- Agroécologie et agroforesterie : intégrer des arbres dans les systèmes agricoles (agroforesterie) pour apporter de l’ombre, réduire l’évaporation, améliorer la biodiversité et stabiliser les sols. Les pratiques agroécologiques visent à renforcer les processus naturels des écosystèmes.
- Fertilisation raisonnée : optimiser l’apport d’engrais, notamment azotés, pour limiter l’émission des gaz à effet de serre et favoriser une meilleure absorption par les plantes. Utiliser des outils d’analyse (satellites, drones) pour une fertilisation de précision.
- Décalage des dates de semis/plantation : ajuster les calendriers de semis et de récolte pour que les phases les plus sensibles des cultures (floraison, remplissage des grains) évitent les périodes de stress climatique (sécheresse, fortes chaleurs)
Les pratiques spécifiques par culture sont les suivantes :
- Maïs :
- Adaptation des dates de semis et choix variétal : les agriculteurs avancent souvent les dates de semis et utilisent des variétés plus tardives lorsque la pluviométrie et les températures le permettent ou des périodes plus précoces pour éviter le stress hydrique en fin de cycle. L’exploitation de la diversité génétique de la floraison du maïs est aussi étudiée.
- Augmentation de l’apport en engrais (dans certains contextes) : des niveaux plus élevés d’engrais peuvent réduire les baisses de rendement sous les climats futurs mais cela varie selon les cultivars.
- Diversification agricole et agroforesterie
- Blé :
- Sélection variétale : développer des variétés résistantes aux stress hydriques et thermiques
- Décalage des cycles de culture : semis plus tôt ou variétés plus précoces pour esquiver le stress hydrique.
- Diversification de l’assolement : introduire des légumineuses et des rotations plus complexes.
- Agroforesterie et haies : apporter de l’ombre et préserver l’humidité du sol.
- Mélanges de blé : utiliser des mélanges de variétés avec des résistances complémentaires
- Riz :
- Système de Riziculture intensive (SRI): cette approche permet d’augmenter les rendements tout en réduisant la consommation d’eau (jusqu’à 50%) et les émissions de gaz à effet de serre (méthane, jusqu’à 70%). Elle repose sur :
- La plantation de jeunes plants sains
- L’optimisation de l’espacement entre les plantes
- La construction d’un sol fertile (matière organique) et sain
- L’application d’une quantité minimale d’eau nécessaire.
- Développement de variétés résilientes : résistance aux ravageurs, maladies, températures extrêmes, sécheresses et tempêtes.
- Système de Riziculture intensive (SRI): cette approche permet d’augmenter les rendements tout en réduisant la consommation d’eau (jusqu’à 50%) et les émissions de gaz à effet de serre (méthane, jusqu’à 70%). Elle repose sur :
- Sorgho :
- Sélection de variétés intelligents face au climat : cultivars qui allongent les cycles végétatif et reproducteur, améliorent le remplissage des grains et optimisent l’allocation des ressources.
- Irrigation au goutte-à-goutte et capteurs d’humidité pour une utilisation efficace de l’eau.
- Aménagements pour la conservation de l’humidité : digues liées, fosses et cultures en courbes de niveau.
- Sorgho de décrue : au Tchad, cette variété est cultivée après le retrait des eaux, permettant deux récoltes par an et offrant une solution innovante face aux défis climatiques dans les zones inondables.
- Soja :
- Cultures associées (polyculture) : l’association du soja avec le maïs peut améliorer les rendements et réduire les pertes.
- Sélection de variétés adaptées résistantes aux conditions climatiques irrégulières (pluviométrie)
- Gestion des maladies : la sélection de variétés avec des cycles plus longs, l’ajustement du calendrier de plantation et l’application précoce de fongicides sont des stratégies pour atténuer les risques de maladies fongiques.
- Manioc :
- Agriculture intelligente face au climat : adoption de pratiques de gestion des nutriments, de l’eau et des sols.
- Application d’engrais organiques : c’est une pratique couramment adoptée
- Diversification des cultures et variétés multiples pour augmenter la résilience
- Changement des techniques de mise en terre : modification de l’orientation des tiges de manioc
- Cultures associées : le manioc est souvent associé au maïs.
- Développement de variétés tolérantes aux conditions extrêmes (pluies excessives, chaleur, inondations) et résistance aux ravageurs et maladies.
3.Nuances
Une équipe de chercheurs américains et chinois a utilisé des données provenant de 12 658 régions de 54 pays pour déterminer dans quelle mesure les producteurs de denrées alimentaires se sont adaptés à différents changements climatiques. Ils ont appliqué ces relations historiques à des modèles simulant la production agricole future à mesure que les températures augmentent et que les économies se développent, et ont comparé les pertes avec un monde hypothétique dans lequel le réchauffement planétaire se serait arrêté au début des années 2000.
Selon l’étude, dans un scénario de réchauffement extrême, le rendement relatif d’une culture telle que le soja chuterait de 26 % d’ici 2100, même en tenant compte de l’adaptation, de l’augmentation des revenus et de l’effet d’une croissance plus rapide des plantes due à l’augmentation du dioxyde de carbone dans l’atmosphère.
Un scénario de réchauffement plus réaliste – plus proche du niveau que les politiques actuelles provoqueront – entraînerait des pertes de rendement de 16 % pour le soja, de 7,7 % pour le blé et de 8,3 % pour le maïs, selon l’étude. Le riz est la seule des six cultures étudiées dont les rendements augmenteraient en raison du changement climatique, avec un gain attendu de 4,9 %.
La population mondiale devrait passer d’environ 8 milliards aujourd’hui à 10 milliards d’ici la fin du siècle, ce qui accroîtra la demande de denrées alimentaires à mesure que la pollution par le carbone modifiera les conditions météorologiques. Les chercheurs ont constaté que les pertes les plus importantes toucheraient les régions modernes « greniers à blé » dotées de terres très productives, mais ils ont ajouté que les habitants des pays les plus pauvres seraient parmi ceux qui auraient le moins les moyens de se procurer de la nourriture.
La recherche, qui utilise des méthodes économétriques pour évaluer l’effet total de l’adaptation, contraste avec les études précédentes qui modélisent explicitement les interactions biophysiques. Une étude publiée dans Nature Communications en 2022 et utilisant cette dernière approche a montré qu’une adaptation en temps voulu des périodes de croissance augmenterait les rendements réels des cultures de 12 %.
Jonas Jägermeyr, chercheur à la Columbia Climate School et coauteur de l’étude, a déclaré que la nouvelle recherche ne couvrait pas les options d’adaptation qui ne sont pas mises en œuvre aujourd’hui et que ses résultats risquaient d’être trop pessimistes.
« Les études d’impact empiriques sont connues pour être trop pessimistes lorsqu’il s’agit de scénarios lointains », a-t-il déclaré. “Les modèles basés sur les processus montrent l’importance des interactions de croissance des plantes qui ne peuvent pas être formées de manière empirique sur la base de données historiques.
Mais ces modèles ont également été critiqués parce qu’ils explorent ce qui est théoriquement possible sans tenir compte des contraintes du monde réel, telles que les défaillances du marché, les erreurs humaines et la disponibilité des fonds.
« Les conclusions [de la nouvelle étude] sont raisonnables, mais elles représentent l’une des extrémités d’un débat scientifique légitime », a déclaré Ehsan Eyshi Rezaei, spécialiste des cultures au Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (Centre Leibniz pour la recherche sur les paysages agricoles).
Il a ajouté : « Je considère ces résultats comme une précieuse confrontation à la réalité empirique montrant que nous ne pouvons pas supposer qu’une adaptation parfaite nous sauvera – même si la vérité se situe probablement entre leurs projections pessimistes et les projections optimistes [d’autres chercheurs] ».
On peut finalement, sans adopter une vision optimiste, avoir quelques raisons d’espérer en apportant les nuances suivantes :
- Différences entre cultures : si la tendance générale est à la baisse des rendements, l’impact varie selon les cultures. Certaines études récentes suggèrent que le riz, par exemple, pourrait connaître une baisse des rendements moins importantes que d’autres céréales (4,9% d’augmentation d’ici 2100 dans un scénario d’émissions modérées) grâce à sa plus grande adaptabilité et la capacité des agriculteurs à ajuster leurs pratiques. En revanche, le sorgho, le blé et le soja pourraient voir leurs rendements chuter de manière plus significative.
- Effet du CO2 : la concentration accrue de CO2 dans l’atmosphère peut , dans certains cas, avoir un effet fertilisant sur certaines plantes (effet de « fertilisation carbonique »), potentiellement compensant en partie les effets négatifs des températures. Cependant, cet effet est souvent limité par d’autres facteurs (eau, nutriments) et ne suffit généralement pas à inverser la tendance globale à la baisse des rendements.
- Stratégies d’adaptation : les bonnes pratiques peuvent atténuer, comme on l’a vu plus haut, les baisse de rendement, mais ne peuvent pas les annuler complètement.
Finalement, malgré les efforts d’adaptation et les bonnes pratiques, la science indique que les cultures vivrières majeures, dont le maïs, le blé, le riz, le sorgho, le soja et le manioc, sont en effet confrontées à un avenir de rendements globalement plus faibles en raison des impacts inévitables du changement climatique. Les stratégies d’adaptation sont cruciales pour minimiser ces baisses et maintenir la sécurité alimentaire, mais elles ne peuvent pas, à elles seules inverser la tendance de fond.
Sources : The Guardian, Nature.