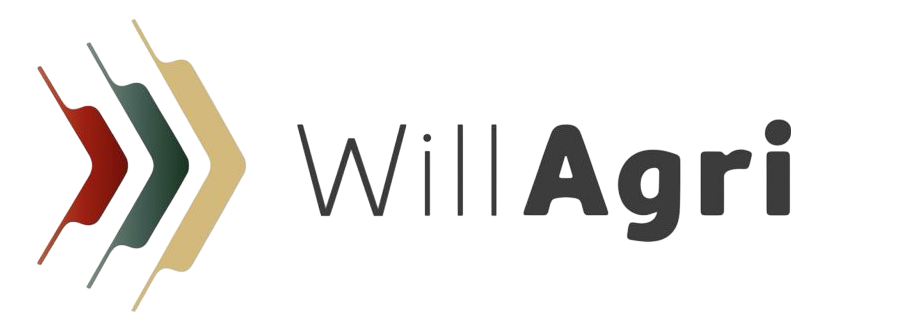Youssef Belmabkhout
Avec Youssef Belmabkhout
Des déchets dont le phosphogypse, issus de la transformation industrielle du phosphate, sont dénoncés à juste titre pour leur impact négatif sur l’environnement sans oublier leur encombrement. Ils étaient considérés jusque-là comme une inévitable fatalité. Des chercheurs de l’UM6P ont trouvé les moyens de recycler ces déchets en ressource industrielle profitable. Une belle avancée pour l’économie circulaire et la science des matériaux.
Une équipe de scientifiques de l’UM6P a accompli une importante percée scientifique : transformer les déchets industriels du phosphate en matériaux poreux stratégiques. Les déchets miniers et le phosphogypse, des sous-produits longtemps considérés comme d’ inévitables dégâts collatéraux pour l’environnement, sont transformés en matériaux solides haute performance à porosités variables. Le changement n’est pas seulement technique. C’est une nouvelle façon de penser la valeur et les déchets et importante contribution de l’Afrique à la science.
Partout dans le monde, les pays riches en phosphate ont été confrontés au même dilemme : comment gérer le tonnage massif de sous-produits industriels générés par le traitement du phosphate ?
Au Maroc, où l’industrie du phosphate est à la fois l’épine dorsale et la fierté de l’économie nationale. Mais, il faut savoir que 4 à 5 tonnes de phosphogypse sont générées pour chaque tonne d’acide phosphorique produite . À l’échelle mondiale l’industrie du phosphate donne lieu à la production astronomique de 150 à 200 millions de tonnes de phosphogypse, stockés sous forme d’immenses champs de colline quand elles ne sont pas rejetées à la mer. Ces immenses stocks polluent les terres, les cours d’eau et la mer.
Les scientifiques marocains se sont lancé un défi : comment transformer ce déchet en matière première pour l’industrie, en produit de spécialité. Leur ambition n’est pas de faire une invention symbolique sans lendemain, mais de créer une industrie nouvelle grâce à une démarche scientifique rigoureuse, utilisant la chimie intelligente et la conception au niveau-système.
C’est précisément l’exploit réalisé par l’équipe dirigée par le professeur Youssef Belmabkhout et le Dr Ayalew Assen au Centre de recherche d’excellence de Chimie appliquée et d’Ingénierie de l’UM6P (ACER CoE).
Leurs premiers travaux ont consisté à transformer le phosphogypse – autrefois un sous-produit mis au rebut – en objet de recherche avancé de de la science des matériaux. Ils ont, pour cela, changé de paradigme dans notre conception des résidus industriels
Non pas par des gains marginaux, mais en initiant un changement de paradigme dans la façon dont nous comprenons les résidus industriels, la catalyse et la création de valeur circulaire.
Dans le cadre d’un parcours de recherche spécifique concernant le phosphogypse (PG), l’équipe ACER a mis au point un processus durable pour convertir le PG en non pas une, mais en deux classes de matériaux fonctionnels : les zéolithes et les cadres métallo-organiques à base de calcium (Ca-MOF). Ces solides poreux qui sont au cœur des principaux processus industriels – de la capture du CO₂ et de la déshydratation de l’alcool – pourraient potentiellement être utilisés pour la détection moléculaire et les transformations catalytiques.
Production de matériaux avancés à partir de déchets
Le phosphogypse est une lourde responsabilité . Le Maroc en produit à lui seul des millions de tonnes par an, dont une grande partie est stockée dans d’énormes décharges à ciel ouvert. Son profil chimique, dominé par le CaSO₄·2H₂O, contient également de la silice, de l’alumine, du calcium et aussi des traces de dizaines d’autres métaux. Il pose depuis longtemps un délicat problème environnemental.
« Nous ne le considérons pas, explique le professeur Belmabkhout, comme un déchet mais comme un ensemble d’éléments du tableau périodique : silice, alumine, calcium… et aussi des traces de dizaines d’autres métaux. »
L’approche de cette recherche est aussi ingénieuse que stratégique et simpl. Le PG est, tout d’abord, dissous dans une solution alcaline douce. La silice et l’alumine sont séparées et utilisées pour synthétiser une zéolite appelée cancrinite (CAN), tandis que le résidu riche en calcium est transformé en plusieurs formes de Ca-MOF.
Parmi les MOFs (Matériaux Organo-Métalliques) synthétisés, citons le SBMOF-2, le Ca-BDC et et Ca-BTC, chacun ayant des propriétés propres adaptées à un usage industriel. Par exemple, les zéolithes de cancrinite dérivées du PG ont montré d’excellentes performances de capture du CO₂, surpassant des produits similaires obtenus à partir de précurseurs commerciaux. Plus frappant encore, le MOF Ca-BTC a été capable de tamiser sélectivement les molécules d’eau d’alcool, une application ayant d’énormes implications pour la purification du bioéthanol et la récupération des solvants industriels. Ce n’est que la partie émergée de l’iceberg, de nombreuses applications restent à explorer.
« Cette capacité de séparation eau-alcool n’était pas connue dans ce cadre là », poursuit le professeur Belmabkhout. Et cela provient d’un matériau dérivé de déchets et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. C’est la beauté de la chose. »
Une logique d’économie circulaire

Des chercheurs marocains transforment les sous-produits de la roche phosphatée en or industriel
Pour saisir les enjeux, posons ceci : près de la moitié de l’énergie industrielle mondiale est consommée dans les processus de séparation et de transformation des produits chimiques de purification, de craquage des hydrocarbures et de production de polymères.
« Tout ce qui vous entoure », souligne M. Belmabkhout, est le résultat d’opérations de séparation et de transformation. La seule purification des oléfines pour la production de plastique consomme 1 % de l’énergie mondiale. »
C’est là qu’interviennent les matériaux poreux. Les zéolithes et les MOF agissent comme des tamis moléculaires, séparant les composés en fonction de leur taille, de leur polarité ou de leur affinité.
Ils sont essentiels dans les catalyseurs, les membranes et les filtres à base d’adsorption. Mais leur utilisation industrielle généralisée est souvent bloquée par le coût élevé de leur synthèse.
« Vous avez besoin de matériaux avec des architectures extrêmement contrôlées, déclare M. Assen. Mais la synthèse repose souvent sur des précurseurs coûteux, des solvants agressifs et des solutions énergivores. »
L’utilisation du phosphogypse comme précurseur résout plusieurs problèmes à la fois : il est abondant, bon marché et chimiquement polyvalent. Plus important encore, il ancre la production de matériaux de haute technologie dans une logique d’économie circulaire à la fois pragmatique sur le plan industriel et stratégique sur le plan environnemental.
Un Catalyseur d’un nouveau genre
La méthodologie de l’équipe ACER ouvre de nouvelles voies non seulement pour la science des matériaux, mais aussi pour la façon dont nous pensons les flux de ressources dans la chaîne de valeur du phosphate. Traditionnellement, les déchets miniers PG et autres phosphates étaient exclus de la boucle d’innovation. Par exemple, le PG est stocké en tas et n’est que partiellement réutilisé dans l’agriculture ou la construction.
Mais comme le souligne le professeur Belmabkhout, même l’étape d’enrichissement, la première filtration du minerai de phosphate, génère de multiples couches de « sous-produits » sans valeur. « Après enrichissement,poursuit-il, seules les particules inférieures à 60 microns sont acheminées vers la chaîne de production. Le reste – grosses particules, queues, matériaux non conformes – demeure dans la mine, alors qu’il est chimiquement riche. Cette idée fait écho à la logique de la recherche de pointe en chimie verte : commencer par ce qui est abondant, pas ce qui est pur. « Pourquoi ne pas concevoir des matériaux avancés à partir d’impuretés ? C’est là que réside la véritable innovation. »
Cette philosophie remet également en question les notions conventionnelles des chaînes d’approvisionnement en Afrique. Plutôt que d’exporter des matières premières et d’importer des composants de grande valeur, ce modèle édifie la sophistication technologique directement sur les intrants bruts locaux. En effet, il court-circuite la boucle de dépendance globale de l’Afrique.
La frontière entre produit et déchet disparait
Bien que la recherche en soit encore au stade de pilote, ses implications sont industrielles. Le procédé permet d’obtenir des matériaux poreux purs en phase avec des structures reproductibles, vérifiées par XRD, FTIR, SEM-EDX et des mesures d’adsorption de gaz.
Plus important encore, les calculs coûts-bénéfices sont prometteurs : sur la base des bilans massiques et de l’analyse préliminaire des rendements, les conversions de PG en zéolithe et de PG en MOF sont concurrentielles avec les méthodes traditionnelles.
« Ce travail jette les bases de la mise à l’échelle », déclare M. Belmabkhout, non seulement dans les laboratoires, mais potentiellement dans des unités modulaires à proximité des sites miniers. Nous pourrions imaginer des plateformes intégrées qui valorisent le PG sur site, convertissant ainsi des déchets environnementaux en produits technologiques exportables. »
Par-delà les zéolithes et les Ca-MOF, l’équipe de recherche d’UM6P étudie également la production de matériaux silicatés mésoporeux (MSM), d’alumine et de matériaux à base de phosphate de silice-alumine à l’aide d’autres sous-produits du phosphate.
Parallèlement, l’équipe a synthétisé quatre classes de MSM à partir de deux types de déchets miniers de phosphate, atteignant des capacités d’élimination du plomb de plus de 800 mg/g, comparables à celles des meilleurs matériaux de la littérature scientifique.
La leçon est claire : l’ancienne distinction entre déchet et produit est en train de s’évanouir. Et l’avenir de la science des matériaux pourrait bien s’enraciner dans la réutilisation stratégique de ce qui était autrefois rejeté.
Une nouvelle ère de l’histoire des matériaux
En fin de compte, ce qui rend ce travail novateur, ce n’est pas seulement la performance technique des matériaux, mais aussi le recadrage conceptuel des déchets en tant que base de ressources pour le 21e siècle.
« Auparavant, le PG était un problème en fin de chaîne », a déclaré Belmabkhout. « Aujourd’hui, il inaugure une nouvelle ère de l’histoire des matériaux.
L’enjeu est de taille. À mesure que les défis climatiques s’intensifient et que l’économie circulaire devient une urgence, la demande de matériaux durables, peu coûteux et performants ne fera que croître. L’Afrique, avec ses vastes réserves de ressources sous-utilisées et de talents scientifiques, est particulièrement bien placée pour jouer un rôle de premier plan.