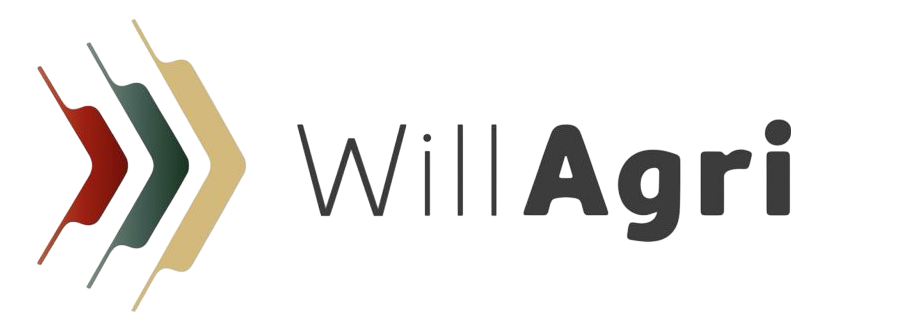Après deux expériences postdoctorales, à l’Eawag (Institut fédéral suisse des sciences et technologies de l’eau), puis à l’Université du New Hampshire (États-Unis), Dr. Myriam Benkirane a rejoint les rangs de l’Université Mohammed VI Polytechnique. Elle y poursuit ses recherches sur la modélisation hydrologique et la télédétection, en collaboration avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT) à Boston.
La modélisation des phénomènes hydrologiques extrêmes repose sur l’intégration de plusieurs catégories de paramètres et de données tels que les précipitations intenses, les crues éclair les crues pluviales ou océaniques. Elle doit surmonter trois obstacles majeurs :
- Il n’existe pas suffisamment de stations de mesure de données dans les environnements montagneux arides.
- Nous avons affaire à un climat non stationnaire provoqué, en grande partie, par le changement climatique. Le climat, jadis humide, de certaines régions est devenu aride suite au changement climatique et à l’asséchement des ressources hydriques.
- Viennent, enfin, les événements combinés qui constituent un domaine primordial auquel les chercheurs doivent être particulièrement attentifs. Ce genre d’évènements est complexe car, par exemple, il combinera une précipitation intense avec une hausse du niveau de la mer ou la fonte des neiges printanière qui causera des dégâts importants tant matériels (destruction des infrastructures) qu’humains.
Donc, que doivent faire, en pratique, les experts que nous sommes ? Nous combinons les statistiques des événements extrêmes non stationnaires avec des modèles dits pluie-débit et pluie hydraulique, afin de trouver et fournir des indicateurs aux gestionnaires sur, par exemple, les risques d’inondation. Ce sont des modèles universels, c’est-à-dire des
modèles physiques, stochastiques et conceptuels. Nous pouvons ainsi modéliser l’événement crue avec la précipitation et d’autres paramètres comme la température, l’humidité de sol, le niveau de la neige, etc., pour calibrer un débit et le comparer au débit observé. Mais les gaps du débit observé demeurent un grand point d’interrogation. Comment combler ces gaps ? Est-ce que le débit simulé correspond vraiment au débit observé ou a-t-on a une sous-estimation ou une surestimation de ces débits-là ?
Les limites de la modélisation actuelle
La pression sur les ressources hydraulique rend donc vitale la modélisation hydrologique et la prévision probabiliste, notamment en matière de risque d’inondation. Un autre outil est la planification avec scénarios. En quoi consiste-t-elle ? On répartit les ressources en eau potable par secteurs utilisateurs en leur attribuant un quota sous forme de pourcentage. Les secteurs sont très divers : l’agriculture, l’écologie, les villes, l’irrigation des espaces verts, des jardins, des forêts, etc. Ce travail exige, au bout du compte, à procéder à des arbitrages. Ce sont les pouvoirs publics qui doivent les faire.
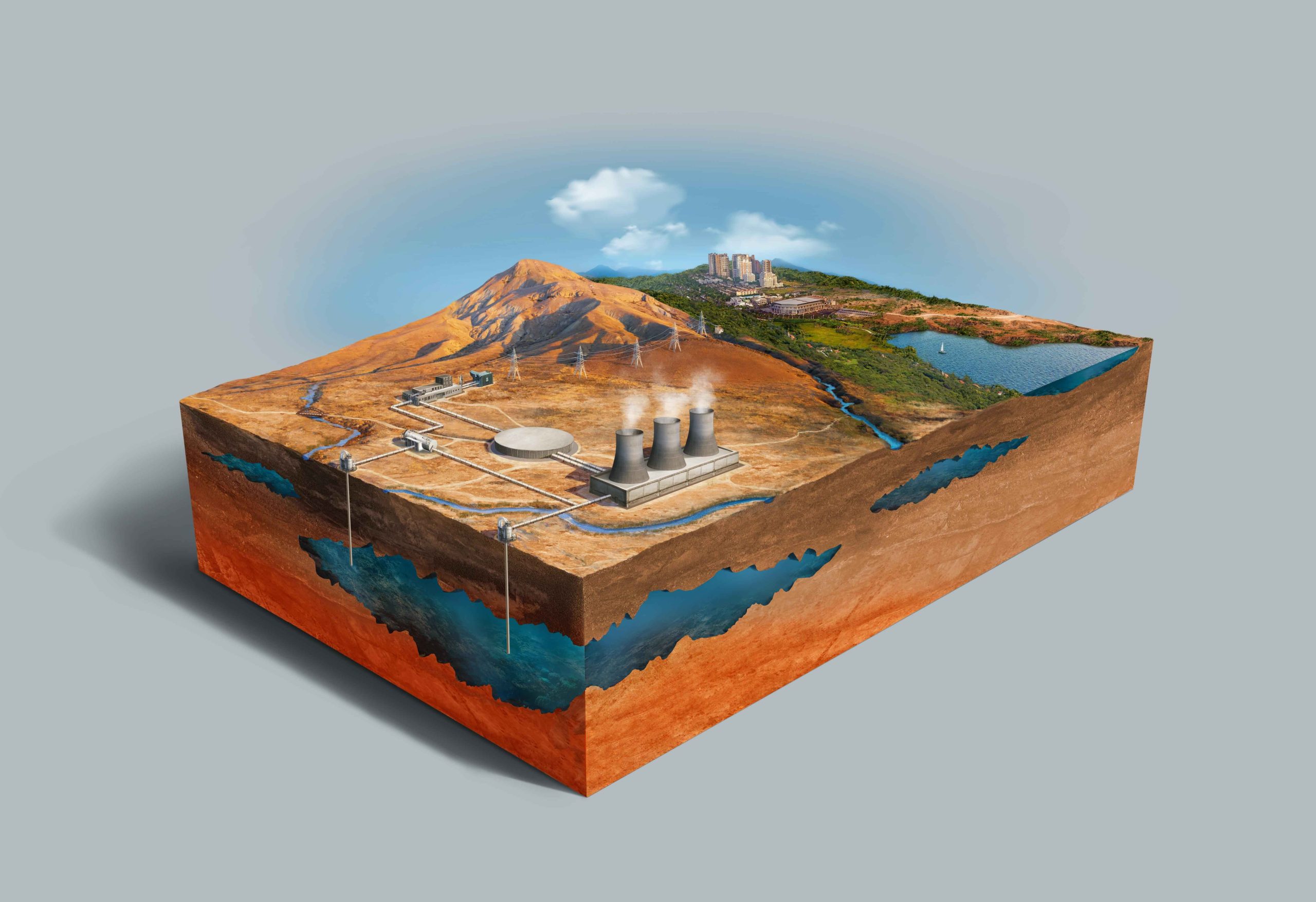
La modélisation hydrologique porte aussi sur l’état des stocks. Nous quantifions les stocks des nappes souterraines, des glaciers, des lacs, des rivières, des océans pour savoir comment ces stocks-là se déploient, augmentent dans certaines régions et pas d’autres…Ce bilan nous permet de comprendre l’évolution du comportement du cycle hydrologique sous l’effet du changement climatique.
La quantification des stocks ne va pas de soi. Ainsi, si je prends l’exemple du Maroc, la quantification des stocks d’eau de ses barrages est faussée. Pourquoi ? Parce des sédiments en quantité s’y accumulent lors de chaque crue. Or, par manque de vigilance, on ne fait pas des dragages, des vidanges de fonds, ce qui favorise l’accumulation des stocks année par année. Quand une précipitation se produit, on mesure la hauteur d’eau et on note que cette hauteur d’eau a augmenté de 20 mm, par exemple. Alors, qu’en fait, cette nappe d’eau repose sur des sédiments qu’on devrait retirer pour avoir une mesure exacte de la quantité d’eau.
On doit pouvoir disposer des quantités réelles des stocks pour pouvoir faire une prévision significative. Car, c’est quoi une prévision ? On se base sur l’historique, on valide par le présent pour connaître le futur. Donc, si au présent, nous n’avons pas des données correctes, nous devrons faire face à de nombreuses incertitudes sur la prévision du futur.
C’est une question d’algorithme et de données et aussi d’intelligence artificielle. Mais ce n’est pas tout. Si le fait observé est faussé, ni les algorithmes, ni l’intelligence artificielle ni aucun modèle robuste n’y feront rien. La prévision sera faussée. Quoiqu’il en soit, nous aurons toujours une incertitude. On peut certes calculer l’incertitude, mais elle ne disparaîtra pas, car il y a, au bout, l’incertitude liée au matériel de mesure.
Pour l’instant, un système d’alarme relativement rudimentaire
Pour l’instant, en combinant nos statistiques d’événements extrêmes et les modèles de pluie-débit on fournit des indicateurs de risque utilisables par les gestionnaires. Les décideurs utilisent ces indicateurs pour pratiquer une gestion durable de ressources.

Comment passe-t-on du modèle à l’alarme ? Sur chaque terrain, nous installons des stations météorologiques ou hydrométéorologiques. Tout dépend de ce que l’on veut mesurer. Si on veut mesurer les caractéristiques climatiques et les débits, nous installons des stations hydrométéorologiques généralement utilisées par les hydrologues. Ces données sont enregistrées avec des pas de temps fins ; on peut utiliser à notre guise dans nos laboratoires. Nous avons des données de l’ordre de deux minutes
On peut, donc, redimensionner les données à la hausse ou à la baisse, vu que le minimum est de deux minutes. Nous aurons ensuite besoin de certaines données, comme l’occupation de sol, le couvert forestier ou le couvert agricole. Ces données-là sont extraites de bases satellitaires. Il y a, certes, des organismes comme l’Office régional de Mise en Valeur agricole (ORMVA) ou l’Agence du Bassin hydraulique de Tensift (ABHT) au Maroc qui disposent de ces données. Mais, généralement nous nous avons recours aux satellites pour recevoir des données claires sans couvert nuageux ou autre.
Nous exploitons ensuite nos statistiques. Nos prévisions ne sont pas intégrées à des systèmes d’alerte globaux qui donnent à l’agriculteur une série d’informations sur l’état des sols, les taux d’humidité ou la météo. Actuellement, nous avons des systèmes d’alerte assez basiques, traditionnels. Nous ne déclenchons des alertes par sirène que 30 minutes, voire une heure, avant l’occurrence d’un événement extrême, pour informer la population qu’une crue, par exemple, va se produire.
Vers des modèles plus fiables et plus robustes
On se base donc sur sur les données satellitaires que l’on corrige pour obtenir des données relativement correctes qu’on pourra utiliser dans nos recherches et nos modèles. Nous sommes en train de travailler sur le développement de modèles suffisamment robustes pour prendre en charge toutes ces incertitudes. Nous avançons rapidement vers la mise au point de modèles très fiables.
Notre équipe, travaille, actuellement sur des systèmes d’alerte assez robustes et assez intelligents afin de prédire et de donner à l’agriculteur des intervalles de dates avec une incertitude plus réduite, dans les prévisions d’événements extrêmes. Nous ferons savoir aux agriculteurs si leurs terrains seront submergés, nous les informerons sur la teneur en eau de leurs sols, etc. Nous offrirons aux agriculteurs un outil d’aide à la décision qui s’intégrera dans l’ensemble des outils fournis aux agriculteurs branchés qui utilisent les nouvelles technologies.
Justement, ce seront des outils assez complexes qui combinent à la fois les données de terrain, les données observées par les satellites et les modèles stochastiques et conceptuels, à base physique. C’est, finalement un complexe de modèles qui aboutira à un modèle unique donnant à l’agriculteur exactement ce dont il aura besoin comme données.
Ce que je peux proposer aux décideurs, c’est déjà un outil d’anticipation des aléas. Donc avec mon équipe, nous allons développer un outil d’anticipation. Nous aurons un outil de prévision de précipitation et des niveaux d’eau de rivière assez fiable, avec bien sûr une petite incertitude, mais pas comme celle qu’on voit avec le système d’alerte traditionnels. Nous allons aussi leur fournir des systèmes de gestion de l’eau. Ce seront des applications qui vont fournir non seulement l’état de la météo actuelle et l’état du sol mais aussi un mode de gestion de l’eau disponible.

Biographie du Dr Myriam Benkirane
Après plusieurs expériences de recherche internationales en Europe et en Amérique du Nord, le Dr Myriam Benkirane a rejoint les rangs de l’Université Mohammed VI Polytechnique. Elle y poursuit ses travaux sur la modélisation hydrologique et la télédétection, en collaboration avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT) à Boston. Ses recherches s’inscrivent dans une démarche intégrée visant à renforcer la résilience hydrologique des régions arides et semi-arides face aux effets du changement climatique, à travers le développement de modèles hybrides et de systèmes d’alerte intelligents fondés sur l’intelligence artificielle, les observations satellitaires (GRACE, SWOT, SMAP) et les données de terrain.